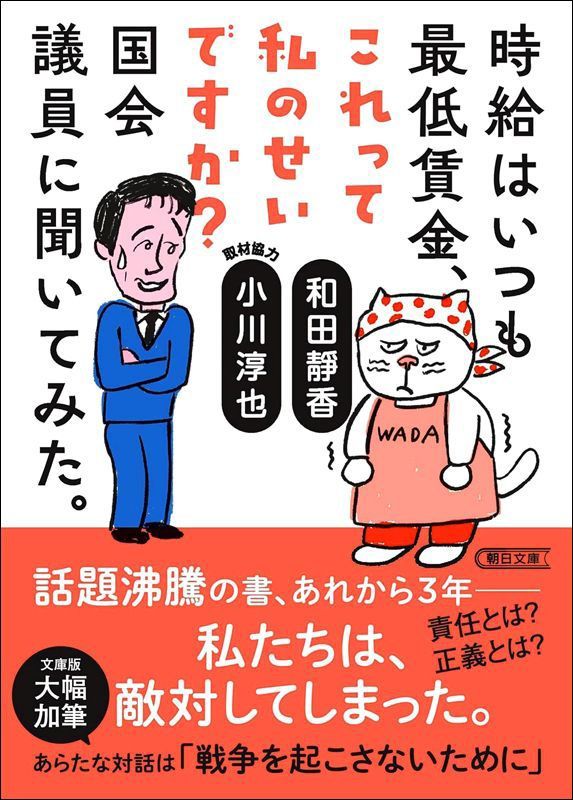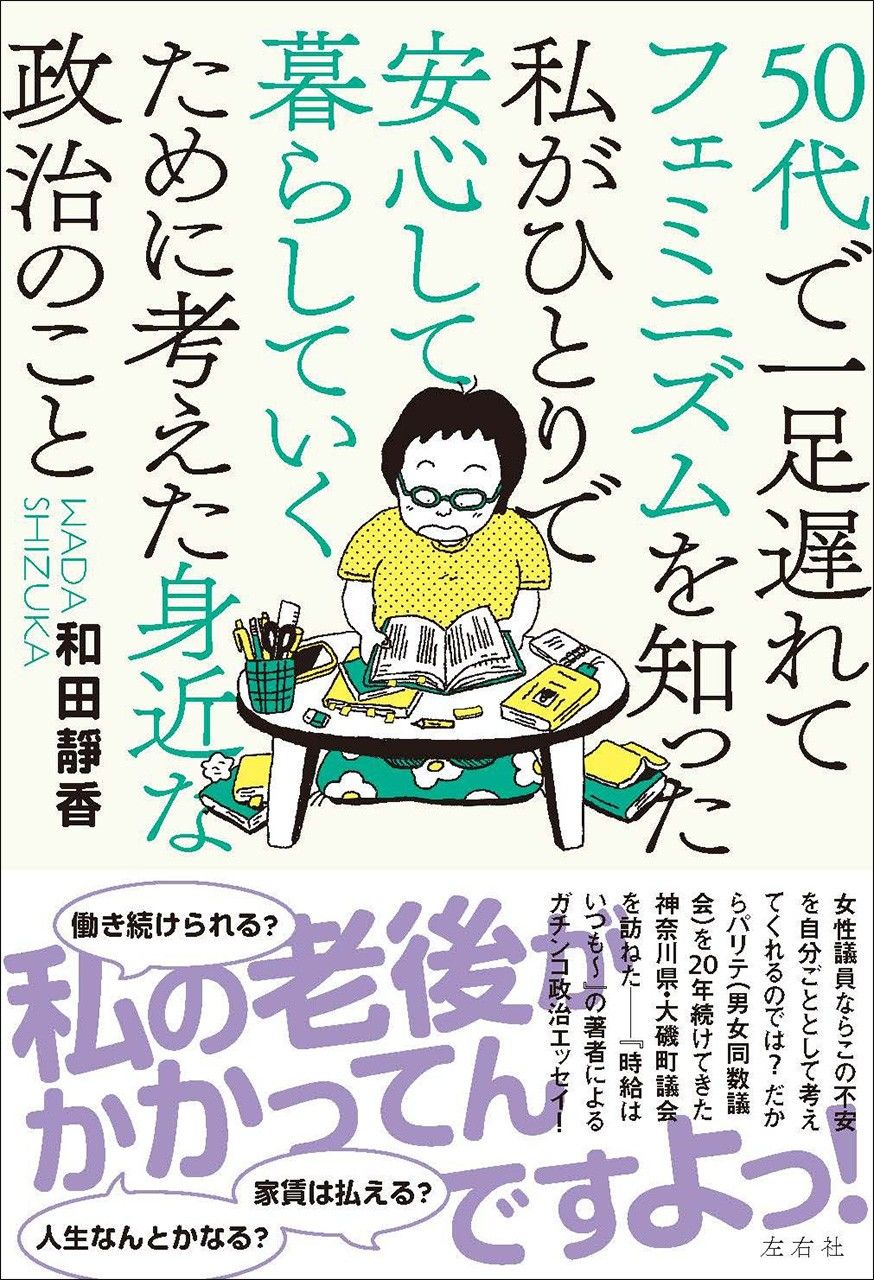Toucher le fond pour mieux rebondir
Wada Shizuka, critique indépendante dans le monde de la musique, avait une cinquantaine d’années lorsqu’elle a commencé à douter sérieusement des systèmes sociaux et politiques au Japon. C’est au plus fort de la pandémie de Covid-19 qu’elle a été confrontée à la pire crise économique de sa vie.
Mais ses problèmes d’argent, elle ne l’a pas oublié, ont commencé bien plus tôt, alors qu’elle n’avait qu’une quarantaine d’années.
« Avant cela, je gagnais ma vie en tant qu’écrivain. Mais après mes quarante ans, j’ai eu beaucoup moins de travail. C’est là que j’ai dû enchaîner les emplois à temps partiel ; supérettes, boulangeries, supermarchés, restaurants, stands où je vendais des onigiri... pour beaucoup dans le secteur alimentaire ».
À chaque fois, elle était payée le salaire minimum. En 2008, à l’âge de 44 ans, elle a travaillé dans une supérette pour 850 yens de l’heure, un salaire qui est resté le même pendant trois ans. Puis elle a présenté sa démission et à ce moment-là, le magasin a publié une offre d’emploi pour un salaire de 900 yens de l’heure. « Je suis rentrée dans une colère noire. Pourquoi ont-ils attendu que je parte pour augmenter le salaire horaire ? »
Même en combinant son travail en tant que journaliste avec un travail à temps partiel, Wada Shizuka gagnait à peine 1,5 million de yens par an (9 000 euros), à peine suffisamment pour vivre, ou plutôt survivre.
« C’était comme si tout était de ma faute », dit-elle. « Je m’en voulais de la voie que je m’étais choisie. D’autres femmes se marient et fondent une famille. Le mariage, ce n’était pas très important pour moi. J’ai regretté de ne pas avoir trouvé un emploi permanent. Je l’ai vraiment regretté ».
En 2020, au début de la pandémie, Wada Shizuka a perdu son emploi à temps partiel, qui lui permettait de joindre les deux bouts. À 55 ans, elle est tombée au plus bas.
Son engagement en politique
Au Japon, les personnes les plus vulnérables ont lourdement pâti de la crise sanitaire. Les femmes surtout. La demande a fortement chuté, forçant de nombreuses entreprises à licencier ou à mettre fin à l’emploi de leurs travailleurs non réguliers. Mais ce sont les femmes qui ont été les plus touchées ; presque deux fois plus que les hommes.
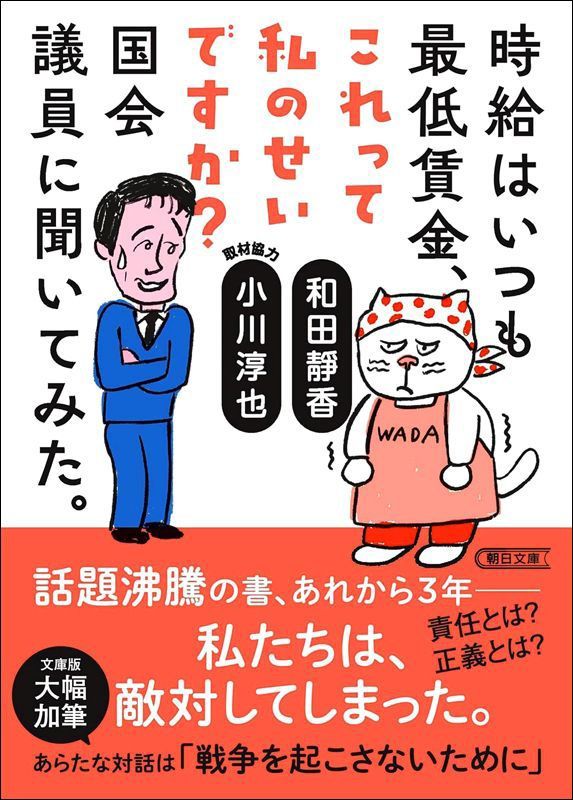
Le livre d’entretiens avec l’homme politique Ogawa Jun’ya a été publié en format poche par les publications du journal Asahi Shimbun en 2024.
Wada Shizuka commence à se poser des questions sur l’avenir ; comment s’en sortira-t-elle quand elle sera plus vieille ? Est-ce uniquement de sa faute si son avenir est aussi incertain ? Alors qu’elle était en proie à l’anxiété et au doute, elle a regardé par hasard un documentaire japonais intitulé Naze kimi wa sôri daijin ni narenai no ka (« Pourquoi vous ne pouvez pas être Premier ministre » ; sorti en 2020) qui suivait sur une période de 17 ans la carrière mouvementée d’Ogawa Jun’ya, membre de la Chambre des représentants (aujourd’hui secrétaire général du Parti démocrate constitutionnel, ou PDC). Inspirée par les efforts déployés par l’homme politique pour concilier ses idéaux avec les réalités du service public, elle décide de le contacter et de lui faire part de ses inquiétudes.
Lorsqu’elle le rencontre en tête-à-tête, Wada Shizuka lui fait part de son désir de travailler avec lui à la rédaction d’un livre abordant ses doutes et ses préoccupations personnelles d’un point de vue politique. Ogawa Jun’ya est littéralement conquis par sa détermination et son enthousiasme et accepte une série de dialogues. À ce moment-là, Wada Shizuka n’y va pas par quatre chemins et lui pose des questions abordant un large éventail de sujets : vieillissement démographique, impôts, inégalités des salaires, sécurité sociale etc. Si elle trouve ses réponses peu convaincantes, elle le met au défi et lui demande des explications. Ces échanges particulièrement virulents apparaissent dans un livre, publié en 2021 sous le titre Jikyû wa itsumo saitei chingin, korette watashi no sei desu ka ? Kokkai giin ni kiite mita (« Est-ce ma faute si mon salaire horaire est toujours au niveau du salaire minimum ? J’ai posé la question à un parlementaire »).
Les femmes plus âgées boucs émissaires de la crise du logement
En lisant ces discussions, on comprend davantage les facteurs auxquels se retrouvent confrontées les femmes célibataires d’âge moyen et plus âgées au Japon, et qui rendent leur vie si difficile et incertaine.
L’un de ces facteurs est le prix élevé des logements. Le gouvernement japonais encourage l’accession à la propriété par des allègements fiscaux et d’autres moyens, mais la jeune femme a vite compris, à ses dépens, que ce dernier n’avait guère intérêt à garantir un logement dans le cadre du filet de protection sociale.

« Lorsque j’ai eu la quarantaine, j’ai constaté avec surprise que je ne pouvais plus payer l’appartement que je louais. C’est comme ça que j’ai commencé à travailler à temps partiel dans une supérette pour compléter mes revenus. Malheureusement, ça n’a pas suffi. C’était reculer pour mieux sauter et deux ans plus tard, j’ai dû déménager. Et j’ai commencé à enchaîner les déménagements, à la recherche d’un logement dont je pourrais payer le loyer. L’agent immobilier me regardais, d’une manière loin d’être objective. “Freelance, c’est ça ? Je crains qu’il n’y ait pas grand-chose pour une célibataire de votre âge”. J’ai commencé à me demander quand je finirais par trouver un nouveau logement. Des semaines, qui sait des mois peut-être ? Et c’est là que j’ai commencé à penser au pire ; il fallait peut-être que je quitte ce monde, et au plus vite ? C’est plus ou moins la situation à laquelle se retrouvent aujourd’hui confrontées un grand nombre de femmes solitaires d’âge moyen et plus âgées. »
Et les logements sociaux ?
« Les logements sociaux sont beaucoup moins chers, mais un grand nombre d’entre eux sont réservés aux familles, même si le nombre de personnes vivant seules est en nette augmentation. Pour ces dernières, les listes d’attente sont longues pour espérer avoir un de ces logements. Le Bureau métropolitain du logement de Tokyo a refusé ma demande, les logements pour célibataires étant réservés aux personnes de 60 ans minimum. »
Le système de retraite à deux vitesses du Japon
De nombreuses femmes comme Wada Shizuka appartiennent à la classe dite de « la période glaciaire de l’emploi », époque qui a fait suite à l’effondrement de la bulle spéculative des années 1980 au Japon. Dans les années 1990 et au début des années 2000, les entreprises embauchent beaucoup moins, plus du tout pour certaines, et de nombreux nouveaux diplômés n’ont d’autre choix que d’accepter des emplois non réguliers (contrats à durée limitée) ou de travailler en freelance en attendant mieux. La situation concerne les hommes comme les femmes, mais à terme, ce sont les femmes qui pâtissent le plus de la situation, et de loin.
« Beaucoup d’hommes qui ont commencé à travailler en tant que travailleurs non réguliers à l’époque ont fini par passer au statut d’employé régulier », explique Wada Shizuka. « Mais pour les femmes, ce n’est pas pareil ; passer du statut d’employée non régulière à celui d’une employée régulière relève quasiment de l’impossible. Le statut d’employée non régulière devient pour elle une voie de garage, et pour beaucoup elle le devient à vie. La différence entre emploi régulier et emploi non régulier a de sérieuses conséquences économiques au Japon, surtout après la retraite.
« Au Japon, le système de retraite comporte deux niveaux », explique Wada Shizuka. « D’une part, il y a le système d’assurance pension pour les employés permanents des entreprises et du gouvernement et d’autre part, le système de pension nationale pour tous les autres. En tant que travailleur indépendant ou employé non régulier, même si vous payez scrupuleusement votre cotisation mensuelle, 16 980 yens en 2024, pendant quarante ans, vous ne toucherez qu’une maigre retraite de 65 000 yens par mois. En supposant que le loyer d’un appartement d’une pièce (à Tokyo) est d’environ 70 000 yens, vous vous retrouvez dans une impasse. Le nombre de logements sociaux est insuffisant. Le gouvernement doit en créer davantage pour permettre à un nombre accru de personnes âgées célibataires aux moyens limités de vivre leurs vieux jours en paix ».
La « barrière des revenus »
Depuis les élections générales d’octobre dernier, la question du rehaussement des seuils de revenus annuels pour le paiement de l’impôt sur le revenu et des primes d’assurance sociale a été discutée à maintes reprises. Il s’agit d’encourager une plus grande participation des femmes à la vie active. Selon le système actuel, l’épouse d’un employé permanent d’une entreprise ou du gouvernement est couverte par la pension nationale en tant que « personne assurée de catégorie 3 ». Condition sine qua non : elle ne doit pas gagner plus de 1,3 million de yens par an (environ 8 000 euros). Elle peut ainsi percevoir des prestations de retraite au moment de l’âge de la retraite sans avoir à cotiser au système. Cependant, dans le cas d’un revenu annuel supérieur à 1,3 million de yens, elle doit cotiser entraînant de ce fait une baisse de son revenu après impôt. Pour éviter cela, nombreuses sont les femmes qui limitent délibérément le nombre de leurs heures de travail, se cantonnant à des emplois à temps partiel peu rémunérés.
Pour Wada Shizuka, ce débat ne devrait pas exister.
« Je comprends, dit-elle. Les gens ont des difficultés, donc ils voient à court terme et donnent la priorité à leur revenu net, après déduction des impôts, plutôt qu’à long terme, sans penser aux avantages dont ils pourront bénéficier vingt ou trente ans plus tard. Mais réfléchissez deux secondes. Le système tout entier d’exonération des cotisations de retraite pour les personnes de la « catégorie 3 » a pour but de maintenir une division du travail fondée sur le sexe, obligeant de nombreuses épouses à se contenter d’emplois à temps partiel mal rémunérés en complément des revenus de leurs maris. Les femmes qui ne sont pas dans cette situation ne bénéficient pas du système, et elles ont tendance à voir d’un mauvais œil les femmes au foyer qui en bénéficient. Ce système actuel est donc à l’origine de divisions entre les femmes ».
Pour Wada Shizuka, les impôts et les cotisations sociales devraient être adaptés au niveau de revenu de chaque individu, homme comme femme.
Pour elle, l’insuffisance de la pension nationale est un problème bien plus grave. Au lieu de tergiverser sur la « barrière des revenus », je pense qu’une discussion sérieuse sur l’augmentation de la pension nationale s’impose », affirme-t-elle. « Il est urgent de restructurer le système de sécurité sociale, mais nos hommes politiques ont bien trop peur et ne veulent surtout pas s’attaquer à ce casse-tête. Il est là le plus gros problème.
Un éveil de conscience laborieux
Wada Shizuka n’a pris conscience que tardivement de la discrimination sexuelle au Japon. Et ce n’est que vers la cinquantaine qu’elle a commencé à se rebeller contre le système. « Quand j’étais jeune, j’acceptais sans m’en rendre compte la discrimination à l’égard des femmes et pis encore, j’y contribuais même d’une certaine manière.
En 1985, lorsque le Japon a promulgué la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi, Wada Shizuka a été engagée en tant qu’assistante de la critique musicale Yukawa Reiko. Considérée comme un modèle pour les femmes combinant travail et famille, Yukawa Reiko recevait de nombreuses demandes d’interviews et de reportages. Cependant, sachant que cette dernière faisait appel à des nourrices, des femmes de ménage et des baby-sitters pour toute sa petite famille, c’en a été trop pour Wada Shizuka. Sa patronne était loin d’être la « superwoman » qu’un grand nombre pensaient qu’elle était.
« Je me suis dit que cela ne valait pas le coup de travailler si c’était pour négliger sa propre famille. Mais aujourd’hui, je réalise à quel point la situation était difficile pour Yukawa Reiko à l’époque, alors qu’elle ne pouvait pas compter sur l’aide de son mari ».
À 27 ans, Wada Shizuka s’est mise à son compte en tant que critique musicale indépendante. Au début, elle était très heureuse de gagner sa vie en écrivant sur les sujets qu’elle aimait. Mais au fil des années, elle s’est de plus en plus sentie blessée par les préjugés sexistes monnaie courante dans l’industrie musicale.
« Des femmes comme Yukawa Reiko ou encore Hoshika Rumiko, la première journaliste japonaise à avoir interviewé les Beatles, ont joué un rôle considérable dans la promotion du rock occidental et de la musique pop au Japon. Mais leur contribution n’a malheureusement pas été reconnue à sa juste valeur. On n’accorde en général que peu d’importance aux femmes écrivains en général, perçues comme capitalisant sur des modes passagères ». Les femmes sont moins bien payées au mot pour le même type d’articles, c’est un fait, et la quantité de travail qui leur est confiée a également tendance à diminuer avec l’âge. Plusieurs dizaines d’années après la promulgation de la loi sur l’égalité des chances en matière d’emploi, l’objectif d’un salaire égal pour un travail égal reste un rêve inaccessible.
En quête de parité dans la sphère politique
Mais désormais, Wada Shizuka ne compte plus sur les hommes politiques pour remédier à ces inégalités. « J’ai compris que le simple fait d’être une femme vous place dans une position inférieure », dit-elle. « Et ceux qui sont privilégiés ne voient bien sûr pas le monde de la même façon que ceux qui sont défavorisés. »
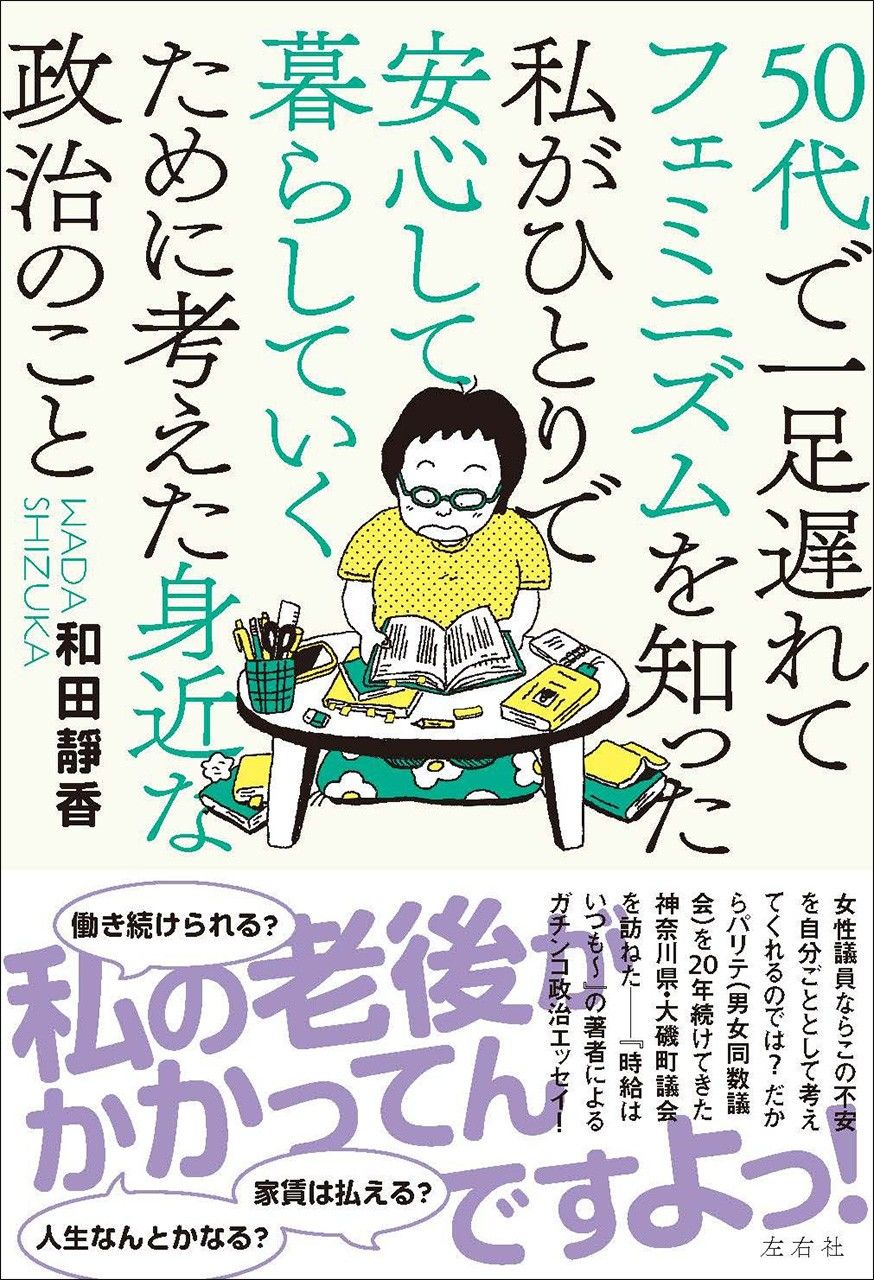
Le livre de Wada Shizuka sur les femmes dans la politique de base, publié aux éditions Sayûsha en 2023.
Actuellement, les femmes ne représentent que 19 % des décideurs au Parlement national. Pour Wada Shizuka, il est urgent d’augmenter ce pourcentage pour garantir aux femmes célibataires un niveau minimum de sécurité économique pour leurs vieux jours. Cela peut notamment se faire par le biais d’une réforme du système de sécurité sociale, l’augmentation du salaire minimum (1 055 yens par heure en moyenne en date du mois d’octobre 2024) ou encore la mise en place de politiques d’aide à l’emploi et au logement pour les femmes âgées. Mais par où commencer ?
Wada décide de se tourner vers le conseil municipal de Ôiso, dans la préfecture de Kanagawa, première assemblée locale du Japon à avoir atteint la parité hommes-femmes. Elle s’entretient avec un large éventail de femmes siégeant au conseil, lequel est toujours fier d’être parvenu à la parité exacte. Elle comprend ainsi qu’il est important d’utiliser les mouvements locaux axés sur les droits des citoyens et des consommateurs pour créer un sentiment de communauté et d’objectif commun. Et les leçons qu’elle a tirées de ces entretiens, elle les évoque dans son deuxième livre : 50-dai de hitoashi okurete feminizumu o shitta watashi ga hitori de anshin shite kurashite iku tame ni kangaeta mijika na seiji no koto (« Réflexions sur la politique de terrain pour un avenir sûr de la part de quelqu’un qui est venu au féminisme sur le tard »), publié en 2023.
Apaiser les divergences d’opinion
Actuellement, Wada Shizuka écrit une série d’articles portant sur les femmes solitaires d’âge moyen et avancé pour un grand magazine mensuel.
Elle brosse notamment le portrait de l’une d’entre elles, si épuisée de devoir jongler entre sa vie professionnelle et sa mère âgée dont elle doit s’occuper qu’elle n’a eu d’autre choix que de prendre sa retraite. Une autre est une professionnelle certifiée, confrontée à l’insécurité d’un emploi gouvernemental non régulier. Et enfin une critique musicale âgée de 68 ans, la collègue la plus ancienne de Wada Shizuka, qui a dû prendre un emploi le soir pour pouvoir joindre les deux bouts. Ces trois femmes ont un point commun : elles remuent ciel et terre, cherchant à faire au mieux avec les cartes qui leur sont données.

Même si Wada Shizuka s’en sort mieux depuis la publication de ses livres, pour elle, la situation n’a guère évolué. « Je me fais toujours beaucoup de souci pour l’avenir », dit-elle. « Il se peut que je doive recommencer à travailler à temps partiel. Je continue à parcourir les petites annonces gratuites dans les gares et les supérettes au cas où, pour consulter les offres d’emploi ».
Mais elle s’est trouvée un autre but.
Wada Shizuka l’a bien compris ; la politique est un monde réservé au sexe fort et atteindre la parité avec ce qui est considéré comme le sexe faible ne sera pas une sinécure. Pour l’instant, elle met ses talents d’écrivain au service des femmes, cherchant à les rassembler. « J’écris mes articles avec l’intention de tendre la main, de trouver d’autres femmes auprès desquelles mes publications trouveront écho et de forger de nouveaux liens. Les femmes se retrouvent trop facilement montées les unes contre les autres, et la question des “assurés de catégorie 3” n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Nous ne viendrons jamais à bout de la discrimination et plus aucune femme ne sera plus jamais élue si nous ne nous unissons pas et si nous ne nous faisons pas entendre d’une seule voix. Je veux commencer par aider à apaiser les divergences d’opinion ».

(Texte et interview d’Itakura Kimie, de Nippon.com. Photos : Nippon.com)