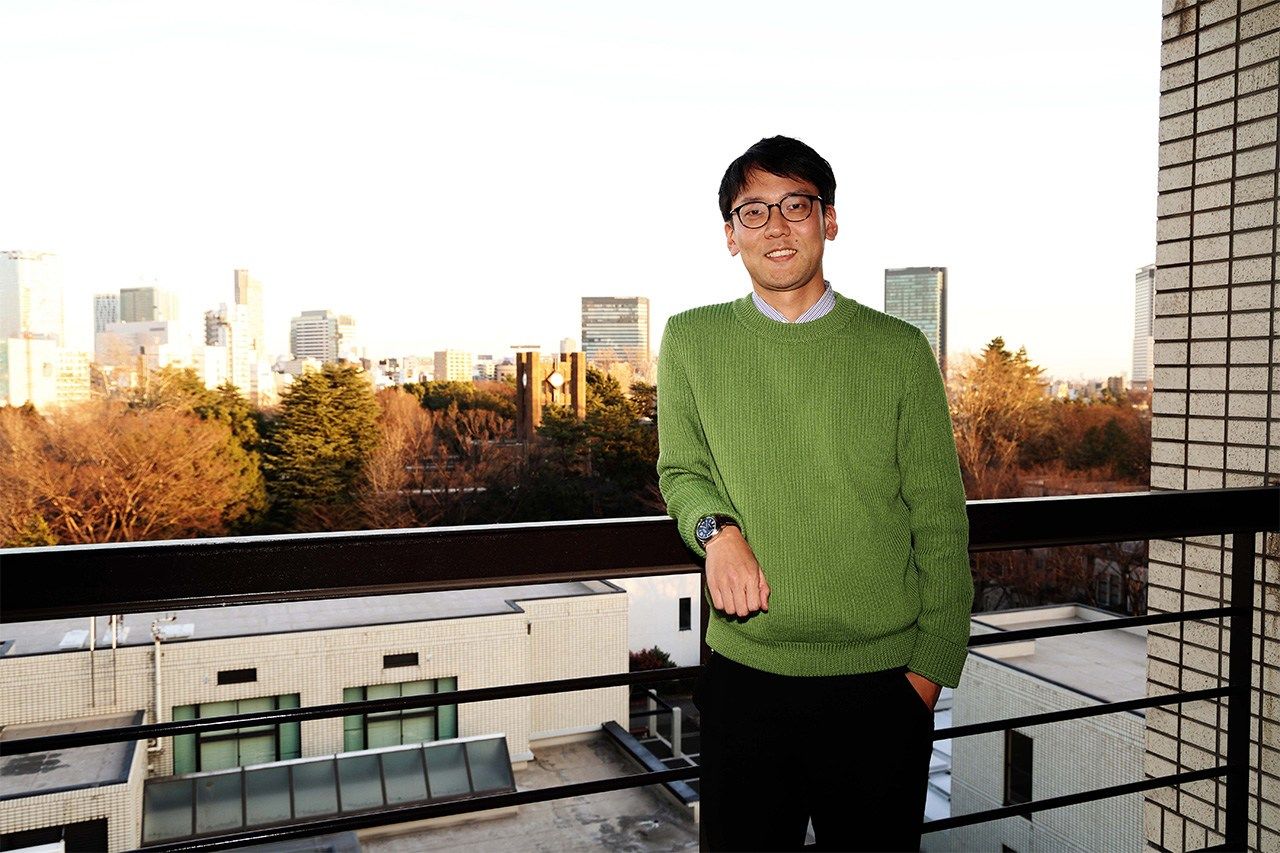Les contradictions du capitalisme dévoilées par la crise du Covid
« Anthropocène » est un terme géologique, qui désigne l’époque où les traces des activités humaines (pour Saitô, « les fardeaux et les contradictions nés du capitalisme ») couvrent la Terre. Dans son livre, « Le Capital dans l’anthropocène » (Hitoshinsei no shihonron), il argue que le capitalisme est la cause fondamentale des problèmes que causent les disparités, ainsi que de la crise climatique, en examine les maux, et propose une nouvelle vision, le « communisme de la décroissance ».
Saitô ne se limite pas à une discussion abstraite. Estimant qu’il devait apprendre du « terrain », il a enquêté partout au Japon pendant deux ans en pleine crise sanitaire, en passant par exemple du temps comme livreur Uber, ou en aidant au dépeçage de biches japonaises, des expériences qu’il raconte dans un autre livre qui a aussi été apprécié du public et intitulé « Je me suis fait une entorse chez Uber, battu contre une biche et j’ai pleuré à Minamata » (Boku wa Uber de nenzashi, yama de shika to tatakai, Minamata de naita). Un troisième titre, « L’Abécédaire du Capital » (Zero kara no shihonron), sorti en janvier, a mis moins de trois semaines pour atteindre les 150 000 exemplaires vendus.
Aujourd’hui, on considère qu’un nouveau livre qui se vend à 10 000 exemplaire est un succès. Qu’est-ce qui fait que des ouvrages fondés sur la pensée de Karl Marx se classent parmi les best-sellers ?
Pour l’auteur, la crise sanitaire y est pour beaucoup. « La pandémie a rendu visible les contradictions accumulées jusque-là par la société, à savoir les écarts économiques et la crise environnementale. »
Dans cette pandémie due à un virus inconnu que la destruction de l’environnement a apporté à la société humaine, 99 % de la population mondiale a vu ses revenus décliner. Les bas salaires des travailleurs essentiels qui ont dû continuer leurs activités tout en étant exposés à la contagion sont aussi devenus visibles. Par contraste, les riches ont vu leur fortune croître. De nos jours, les 1 % les plus riches contrôlent 38 % de toutes les richesses.
« La vie devient de plus en plus difficile, l’emploi instable. Dans un contexte où chacun s’angoisse pour l’avenir, est née une ambiance dans laquelle on se demande si les structures de la société ne posent pas elles-mêmes problème et s’il ne faut pas tout repenser. Mon livre nomme le capitalisme, que personne ne critiquait jusqu’alors, comme l’origine du problème et envisage la sortie de la croissance. Peut-être est-ce parce qu’il met un nom sur la cause de cette angoisse, qu’il a eu un grand écho. »
Marx est mal compris
Lorsqu’il étudiait aux États-Unis, Saitô n’a pu que remarquer la réalité de la pauvreté et des écarts de richesse dans le pays qui est censé être le plus riche du monde. Que la chute de Lehman Brothers et ses répercussions aient affecté les faibles l’a mis en colère. Il a ensuite commencé son doctorat en Allemagne et il a véritablement commencé à faire des recherches sur Marx. Elles l’ont mené aux notes de recherche que Marx a prises à la fin de vie dans ses critiques du capitalisme du point de vue de l’écologie.
Il les a analysées dans sa thèse de doctorat, d’où est issue son livre Karl Marx’s Ecosocialism, couronnée par le prix Isaac Deutscher Preis, décerné à l’ouvrage qui exemplifie le meilleur et le plus innovant dans le domaine de la tradition marxiste. Il avait alors 31 ans, ce qui a fait de lui le plus jeune lauréat de cette récompense, et le premier Japonais. Il est aussi l’un des éditeurs du projet MEGA, qui a pour but de publier les œuvres complètes de Marx et Engels.

La quatrième partie de MEGA, rédigé en langue allemande, auquel Saitô a participé.
Tout le monde, loin s’en faut, n’est pas d’accord avec Saitô qui appelle à dépasser le capitalisme en se fondant sur la pensée marxiste. La critique la plus typique est celle pour qui l’échec qu’a signifié l’effondrement de l’Union soviétique indique à quel point elle est pourrie, et l’absurdité qu’il y a à mentionner Marx de nos jours.
Pour Saitô, « le socialisme n’a pas prévalu en Union soviétique et ne prévaut pas en Chine. C’est plutôt un capitalisme avec l’État et la bureaucratie au sommet de la pyramide. Je veux qu’on comprenne que c’est une erreur de le voir comme le communisme tel que l’a pensé Marx. »
Il ajoute : « Beaucoup de gens disent qu’ils ne veulent pas du socialisme, et que le capitalisme est par conséquent la seule chose qui existe. »
À la fin de sa vie, Marx prônait un communisme des commons (propriété collective) du bas vers le haut, une société de « type commons » dans laquelle se développait l’association, dans le sens d’entraide mutuelle spontanée entre les travailleurs. Saitô appelle cette pensée le « communisme de la décroissance », et c’est pour lui le stade ultime auquel Marx souhaitait arriver.
Pour un indice de prospérité différent du PIB
Résoudre la crise climatique en ayant pour objectif la croissance économique voulue par le capitalisme est impossible, affirme Saitô. Il voit les négociations des COP (conférences des parties à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques), dans lesquelles sont discutées les promesses internationales de réduire à zéro d’ici à 2050 les émissions de gaz à effet de serre, comme du greenwashing, c’est-à-dire une supercherie, et non comme des mesures environnementales.
« Lors de la COP27 de novembre dernier, il n’y a eu aucun progrès pour définir la date de l’abolition des combustibles fossiles. Étant donné qu’une élévation de 1,5 degré a été fixée comme la limite à partir de laquelle le réchauffement climatique aura de graves conséquences sur l’humanité, mais que la garder dans ces limites semble aujourd’hui une cause désespérée, il faut être prêt à voir se multiplier les désastres climatiques comme ces inondations qui normalement ne se produisent qu’une fois tous les trente ou quarante ans, ou ces canicules comme il ne devrait y en avoir que deux fois par siècle. L’environnement est aujourd’hui à deux doigts de la catastrophe. »

Le capitalisme de l’accroissement a apporté aux pays développés une vie prospère et commode, mais il a aussi accéléré la destruction de l’environnement. D’après les données de l’ONG internationale Oxfam, les pays développés se sont approprié les ressources et la main-d'œuvre bon marché du Sud global (les pays en développement), qui supporte la pauvreté. Les 10 % les plus favorisés de la population mondiale émettent la moitié des gaz à effet de serre, et les 50 % les moins favorisés à peine 10 % de ceux-ci.
« Les riches voyagent en jet privé, possèdent plusieurs résidences luxueuses, et veulent même aujourd’hui aller dans l’espace. S’ils ont du temps à ne plus savoir qu’en faire, je voudrais qu’ils investissent dans la santé de la planète qui pousse des cris de détresse. Nous devrions taxer fortement la classe des riches et viser à une nouvelle distribution de la richesse qui fasse grand cas des travailleurs essentiels. »
Le PIB (produit intérieur brut, l’indice économique qui mesure le « résultat » du capitalisme qui recherche la production et la consommation de masse) est aussi un problème.
« On se réjouit ou on s’attriste de l’évolution ou du classement du PIB, mais on ne peut pas s’en servir pour mesurer notre degré de bonheur. Par exemple au Japon, on mange de très bonnes choses, on vit plus longtemps que partout ailleurs, on n’a pas de problème de sécurité, et les transports en commun sont très développés. Nous avons aussi une culture et des arts merveilleux. Ces mérites du Japon ne se reflètent pas dans son PIB. Utiliser un autre indice de valeur que le PIB sera le premier pas pour sortir de la croissance. »
Enfin, le plus important pour sortir de la crise environnementale et corriger les disparités trop grandes de notre société est de développer le domaine des commons.
« Il faut rendre à tous ce que le capital a monopolisé. Je pense qu’il faut sortir les infrastructures fondamentales que sont l’éducation, la médecine, le logement, l’eau ou l’électricité des principes du marché, de la théorie des investissements et de la spéculation, et en faire des biens possédés en commun par tous les citoyens. »
Une expérience de common sur le mont Takao
Erica Chenoweth, qui enseigne les sciences politiques à l’université Harvard, affirme que si 3,5 % d’une population donnée se soulèvent d’une façon non-violente, la possibilité existe que la société soit profondément transformée. Jusqu’à quel point la vision du « communisme de la décroissance » proclamée par Saitô dans ses livres a-t-elle pénétré dans la société japonaise ?
« Au jugé, je dirais 2 %. Les signes d’un mouvement de société ne sont pas encore visibles. Toute la question est de savoir comment gagner le 1,5 % qui nous manque. »
En dépit du fait que « Le Capital dans l’anthropocène » s’est vendu à 500 000 exemplaires, on ne voit pas encore au sein de la société un mouvement pour aborder de front le changement climatique et les problèmes créés par les disparités économiques.
En Europe et aux États-Unis, les jeunes de la « génération Z », représentée par Greta Thunberg ou la génération Y, ont mené des actions comme la grève de l’école, portés par leur colère contre le fait que les initiatives prises pour lutter contre la crise climatique sont insuffisantes.

« Au Japon, la perception du danger demeure faible et ne conduit pas à encore à l’action. Même au sein des théoriciens de l’environnement, on entend encore beaucoup de gens affirmer que on peut, sans changer de système, limiter les émissions de CO2 grâce aux énergies renouvelables et aux nouvelles technologies, que cela créera de l’emploi, et que la croissance est encore possible. On ne cherche pas à regarder la réalité de notre production et notre consommation excessives. J’avais cru possible une coopération pour mettre en place des limites sur la richesse excessive, le fast-food, la fast fashion, mais ces dernières années, je sens de plus en plus un fossé que rien ne pourra combler. »
Saitô suit les initiatives novatrices de grandes villes européennes comme Paris ou Barcelone. Le réseau d’eau de Paris qui était autrefois privatisé est redevenu public, et ce sont les citoyens qui le gèrent à présent ainsi que la ressource en eau. À Barcelone, la municipalité a mis en place des restrictions sur l’usage de l’automobile tout en développant les transports publics, et la ville cherche aussi à ne plus émettre de CO2 en mettant en place des commons dans l’espace urbain pour le reverdir.
Saitô lui-même agit pour faire une réalité d’un common. « Nous avons créé récemment, à trente personnes, une fondation appelé Common Forest Japan qui a acheté 3,5 hectares sur les pentes du mont Takao pour y lancer une expérience de mise en pratique d’un common. »
Le but n’est pas de laisser à l’abandon cette forêt qui ne peut-être transformée en zone commerciale, mais de protéger et de faire revivre la nature comme un bien commun. La fondation prévoit d’y organiser des ateliers d’observation de la nature et de cueillette des plantes sauvages. Si tout se passe bien, elle achètera plus de terrain.
« L’idée est d’avancer un pas à la fois vers un mouvement de société pour créer une société prospère sans disparités économiques, et sans imposer de fardeau à la nature. »
Dans un monde de plus en plus confus
L’avenir du monde est de plus en plus opaque avec la détérioration de l’environnement et la guerre en Ukraine. Cela n’est pas sans créer de dilemme.
« Plus la crise est forte, plus augmente le nombre de gens qui par réaction veulent protéger leurs avantages. Lancer dans ces circonstances un mouvement vers un nouveau communisme n’est pas facile. De plus, cette crise majeure ne saurait être résolue simplement par un mouvement venu de la base. Le risque que la demande pour un pouvoir politique fort augmente est réel. C’est exactement la raison pour laquelle il faut discuter en profondeur de la façon de modifier les grands systèmes comme l’État et le marché. Le problème est ardu. »
« Il ne fait cependant aucun doute que le capitalisme est dans une impasse. Cela exige un mouvement pour protéger la démocratie et la vie des membres les plus faibles de la société, et de l’imagination pour dessiner la société du futur. »
Pour qu’il y ait une prise de conscience la plus large possible des problèmes du système capitaliste, comme la difficulté à vivre que l’on ressent, le sentiment d’isolement, et la pauvreté, il faut réévaluer Marx. Voilà pourquoi, Saitô plaide sans relâche pour le communisme de la décroissance.
« Comment changer le système actuel ? Si chacun y réfléchit, il y aura nécessairement une avancée. Ne serions-nous nous pas à l’aube d’un grand changement qui décidera du sort de l’humanité dans dix ou vingt ans ? »
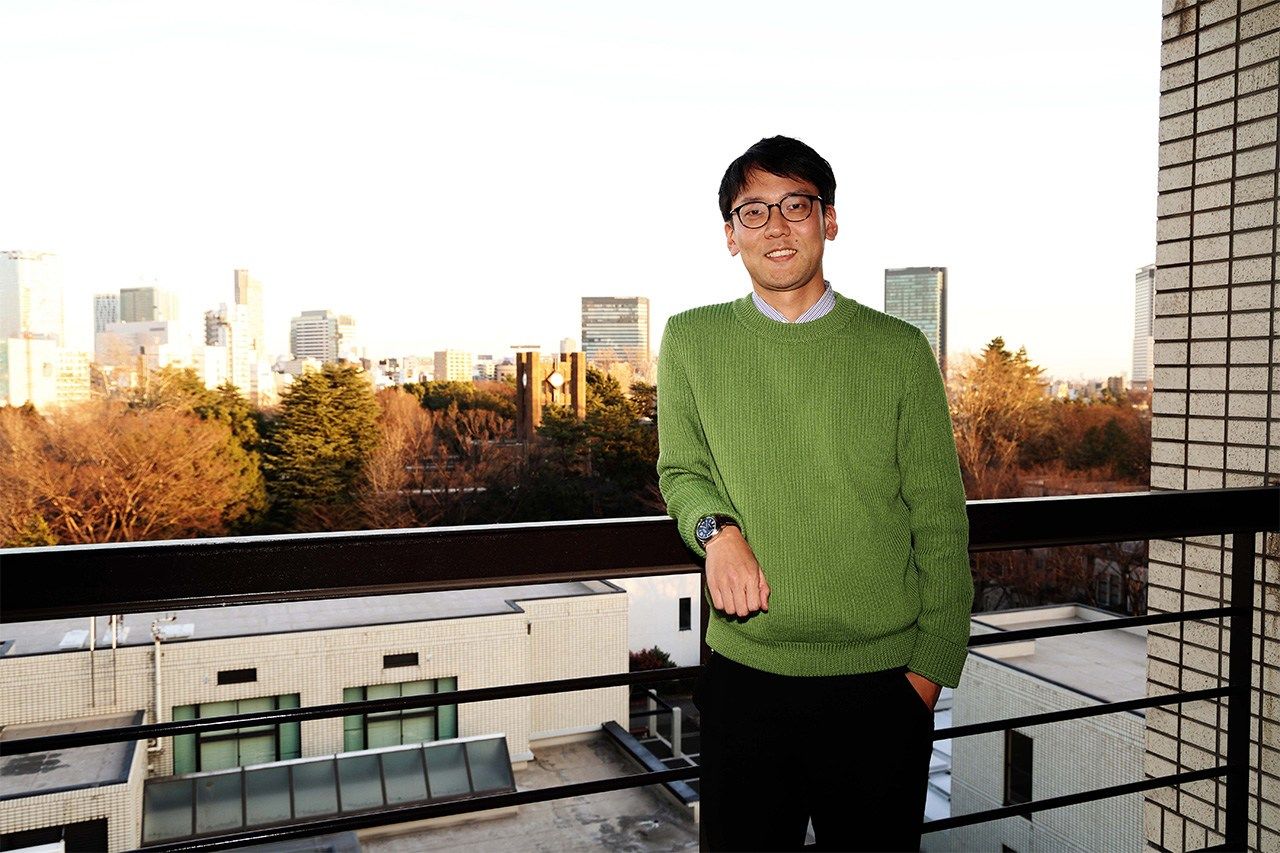
Saitô Kôhei sur le campus Komaba de l’Université de Tokyo
(Toutes les photos : Hanai Tomoko)