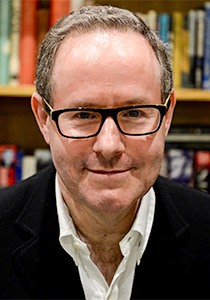Le pouvoir du « kawaii », une obsession japonaise ?
Culture Le japonais- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Le point commun entre un petit bébé et Donald Trump
Que signifie exactement le concept de « mignon », ou kawaii, qui serait l’équivalent le plus proche en japonais ? En 1943, le zoologiste autrichien Konrad Lorenz a expliqué que notre perception du mignon se fondait sur certaines caractéristiques physiques comme une tête ronde, de grands yeux et un petit de nez de bébé. Cette même réaction peut également être déclenchée à la vue d’animaux, par exemple un chiot, un chaton ou un poussin. Même des objets inanimés présentant de telles caractéristiques, comme les peluches et les personnages d’anime, peuvent nous attendrir. De toute évidence, il est dans notre nature de vouloir prendre soin d’un bébé ou d’un petit animal.

L’ouvrage de Simon May, The Power of Cute (photo fournie par l’auteur de l’article)
Mais pourquoi alors le concept de mignon est-il si souvent associé à des choses repoussantes, menaçantes ou énigmatiques ? On pensera entre autres au personnage d’E.T., l’extraterrestre fripé et dégingandé, Hello Kitty et son visage sans expression, ou même Donald Trump et Kim Jong-un et leur apparence androgyne et potelée (deux personnes que May identifie comme ayant des caractéristiques répondant aux critères du mignon). Comment expliquer l’omniprésence du kawaii dans la culture japonaise depuis la Seconde Guerre mondiale ? Pourquoi, depuis plusieurs décennies, le kawaii s’est-il profondément ancré dans les pays occidentaux ? Pourquoi résonne-t-il aussi fortement aujourd’hui ? Simon May, professeur invité au Kings College London, aborde ces nombreuses questions dans son livre The Power of Cute (Princeton University Press, 2019).
Pourquoi une obsession du « mignon » au Japon
En 2001, le philosophe britannique Simon May était professeur invité à l’Université de Tokyo.
« Comme la plupart des personnes qui visitent le Japon, il m’était impossible de ne pas être frappé par l’omniprésence du kawaii, se souvient-il. La première chose que je me suis dite, c’est que cela devait faire partie de l’esprit japonais, en particulier son côté ludique et joueur. »
Mais il s’est rendu compte que le concept de mignon revêtait une signification particulière au Japon, alors que le reste du monde partageait plus ou moins la même définition. « C’est un rejet post-Seconde Guerre mondiale du militarisme et du pouvoir, avance May. Il reflète la volonté forte du Japon de projeter une image pacifique et non menaçante vers le monde extérieur... et surtout à lui-même. » C’est pourquoi on trouvera des personnages mignons dessinés sur les trousses des écoliers aux États-Unis ou en France, mais pas sur des affiches pour la police ou sur des publicités de recrutement pour l’armée, comme c’est le cas au Japon.
Simon May suggère également que le kawai joue un autre rôle distinct : il est une forme de communication sociale. En soulignant que la communication entre Japonais a tendance à être moins ouvertement transactionnelle et plus indirecte, il explique que le fait de se présenter de manière mignonne, que ce soit par des personnes jeunes ou âgées « sert à éviter d’être trop franc ou explicite ».
Dans ses recherches, May met en évidence l’ambiguïté et le caractère indéterministe de l’esthétique kawaii. Hello Kitty, le célèbre personnage de Sanrio, est totalement dénuée d’expression et n’a même pas de bouche. Il n’est pas clair si elle est Japonaise ou non (si on ne réfère pas à son profil officiel). À vrai dire, il est difficile de dire si le personnage est un humain se faisant passer pour un chat ou l’inverse.
Pour May, « kawaii reflète la connaissance et la compréhension que le Japon a acquises sur lui-même au fil du temps, plus précisément en tant que culture qui affirme son indéterminisme. » La culture japonaise permet souvent aux choses d’être à la fois vraie et fausse en même temps. C’est une culture où les distinctions entre homme et femme, humain et animal, animé et inanimé, dieu et être humain ont été traditionnellement moins marquées qu’en Occident.
« En tant que philosophe, je suis frappé par le fait que la pensée au Japon soit moins structurée par des opposés rigides et moins poussée à établir des définitions finales par rapport à la pensée occidentale où c’est très souvent traditionnellement le cas. »
De la même manière, l’art japonais est fortement influencé par l’esthétique ambiguë de la « belle imperfection », que l’on retrouve dans l’expression wabi-sabi. Un bol à thé peut être délicatement asymétrique. Il peut avoir été cassé puis soigneusement réparé grâce à la méthode kintsugi, qui permet de reformer le bol en collant les brisures avec de l’or et de la laque.
Les personnages mignons ont aussi des imperfections notables, soutient May. Par exemple, E.T. est gentil et amusant, mais il « boitille » à cause de sa petite taille et de son physique inadapté à l’environnement terrestre.