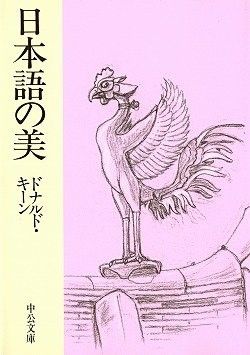« Les Beautés du japonais » : Donald Keene sous un nouveau jour
Culture Livre- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Connu et reconnu
Si Donald Keene (1922-2019) est internationalement reconnu comme l’un des plus grands traducteurs, médiateurs culturels et spécialistes du Japon moderne, il jouissait d’une renommée et d’une admiration encore plus grandes au sein de l’Archipel même. Tous ses opus les plus importants, dont sa magistrale « Histoire de la littérature japonaise » en plusieurs volumes, ont été publiés en traduction japonaise (certains avant même leur tirage en anglais) et ont reçu de prestigieux prix. Les meilleurs magazines littéraires du Japon le sollicitaient pour des articles. Et quand il faisait ses courses dans son quartier à Tokyo, des personnes âgées venaient souvent à lui juste avoir l’honneur de lui serrer la main (ce qui le comblait, m’avouera-t-il). De fait, Keene avait une sorte d’aura et quand à un âge avancé, il a opté pour la nationalité japonaise, la nouvelle a fait les gros titres.
L’érudition de Keene pour tout ce qui touche à la vie intellectuelle du Japon a toujours intéressé l’auditoire japonais, mais ses lecteurs voulaient surtout découvrir ce que lui en pensait, ils avaient envie de connaître sa vie, son parcours et savoir ce qui le touchait. L’homme de lettres a donc écrit plusieurs livres en pensant à ce public japonais et « Les Beautés du japonais » sont parues en 2000 (Nihongo no bi, éditions Chûô Kôron).
La genèse des « Beautés du japonais » vaut qu’on s’y arrête un instant. Keene a 62 ans quand le mensuel Chûô Kôron lui demande d’écrire une série de courts essais personnels, des textes qui préfaceront la revue tous les mois pendant deux ans, de janvier 1985 à décembre 1986. Keene décide de parler tout d’abord des caractéristiques de la langue nippone et il choisit d’écrire directement en japonais plutôt que de faire traduire ses textes de l’anglais, comme il a l’habitude de le faire pour des ouvrages plus longs. Choix naturel, tant il se plaisait à affirmer avec une fierté compréhensible que « le japonais est une langue qui ne m’est pas étrangère ». Ces essais ont ensuite été complétés par d’autres, écrits en japonais pendant la décennie 1980-90, voilà comment naquirent « Les Beautés du japonais ».
Envies d’ailleurs
Ce livre en trois parties s’ouvre donc sur les vingt-quatre courts essais publiés dans la revue. Ce pêle-mêle de faits peu connus recèle de judicieuses remarques sur la langue japonaise. Les textes de la deuxième partie (qui, il faut le dire, font par endroit largement écho à ses écrits en anglais) parlent de l’amitié qui l’a lié à divers artistes, érudits et intellectuels de renom, citons Abe Kôbô, Mishima Yukio, Edwin Reischauer, Shiba Ryôtarô ou la pianiste Nakamura Hiroko. On y trouve également de petites études sur les écrivains Ishikawa Takuboku (1886-1912) et Tokuda Shûsei (1872-1943) ou sur Tsunoda Ryûsaku (1877-64), l’érudit qu’il appelait « mon professeur ». (Pour être honnête, j’ai découvert ses écrits l’année dernière, quand on m’a demandé de traduire en anglais trois essais de la deuxième partie). Dans la troisième partie, Keene écrit des textes autobiographiques, il raconte notamment dans un long récit son voyage sur la Route de la Soie.
J’avais lu presque tous les récits autobiographiques que Keene avait écrit en anglais, mais on trouve dans cette section du recueil des textes inédits. Deux en particulier se démarquent: « Mode de vie, évasion » et « Réflexions sur la mort ».
« Mode de vie, évasion » parle de son envie de prendre la clef des champs, un appel du large qui trouve ses racines dans la solitude de l’enfance. Le leitmotiv de toute sa vie. En voici un extrait :
« Enfant, je devais sûrement être traversé de différents rêves, mais à l’heure d’aujourd’hui le seul qui me reste en mémoire est mon rêve d’évasion. Tout au long de ma scolarité, du primaire au lycée, j’ai toujours été le plus petit de la classe. Même chétif comme je l’étais, avec un peu d’obstination et d’endurance j’aurais tout de même pu faire impression en sport, mais j’étais habitué à naviguer dans les études sans faire aucun effort et jamais l’idée de m’impliquer physiquement et de m’escrimer pour gagner le respect de mes camarades de classe ne m’avait traversé l’esprit. Je n’avais qu’une pensée, si je n’étais accepté pour ce que j’étais avec toute cette “faiblesse” et au mépris de mes vraies qualités, alors mieux valait prendre la tangente et me réfugier dans des mondes autres, là où l’on saurait me comprendre et me jauger à ma juste valeur. »
« Or pour s’évader rien de tel que le cinéma, Comme j’étais sans le sou, je ne pouvais pas y aller autant que j’aurais voulu, ou quand l’envie m’en prenait mais je me débrouillais pour aller voir des films au moins une fois par semaine, le samedi. Il y avait un studio de cinéma non loin de chez moi à Brooklyn et de temps en temps, je traînais exprès dans l’entrée, rêvant qu’un producteur ou un réalisateur me verrait en sortant et s’exclamerait : “Mais tu es exactement le gamin que nous cherchions pour ce rôle !” Malheureusement, j’avais beau persévérer, je restais toujours inaperçu. Personne ne m’a même jamais honoré d’un “Allez, déguerpis, p’tit !” »
« Mon autre méthode consistait à parcourir des yeux une mappemonde à la recherche d’un endroit où je pourrais vivre heureux jusqu’à la fin de mes jours. À l’époque, je collectionnais les timbres, ce qui me permettait de bien connaître les paysages de pays étrangers et le visage de personnalités du monde entier. Les paysages, le climat et l’éloignement de l’île de la Réunion m’ayant séduit, je mis mon dévolu sur ce territoire français de l’océan Indien, et décidais que ce serait mon refuge imaginaire. »
« Bien sûr je n’avais pas sérieusement réfléchi à la manière dont je subviendrais à mes besoins si je parvenais réellement à fuir à la Réunion. Je m’imaginais passer mon temps dans la contemplation de ces myriades de cascades si souvent vues sur mes timbres et je prenais le chemin du bureau de poste dans l’idée de me procurer de nouvelles vignettes. C’est l’idée même d’évasion qui me séduisait, peu importe ce qu’il pourrait advenir après, ces viles questions matérielles étaient balayées d’un revers de main. »
« Mon tout premier voyage à la Réunion eut lieu en 1963, j’avais alors 41 ans. Ces rêves d’évasion m’avaient quitté depuis longtemps mais le soir, en me promenant dans les rues sombres d’une ville sans éclairage, je me demandais quel genre de personne je serais devenu si, jeune, j’avais pu sauter le pas. Le lendemain matin, sur les conseils du réceptionniste de l’hôtel, je suis parti à la découverte des plus beaux sites de l’île. Il y avait en effet tellement de belles cascades. Je me suis rendu également au cimetière de Hell-Bourg, un charmant village de villégiature perdu dans les montagnes. J’ai déambulé parmi les pierres tombales en lisant les épitaphes, certaines avaient deux siècles d’âge, impossible de ne pas me demander si les Français enterrés là avaient trouvé le bonheur dans leur dernier hâvre. »
Fidèle à ses envies d’ailleurs, Keene étudie le chinois, puis le japonais, ces rêves continuent de guider ses pas alors qu’il est soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Conscient pourtant de tous les inconvénients de cette envie de fuite en avant, il confesse pourtant que c’est justement ce besoin d’ailleurs qui lui a permis de s’épanouir, de trouver sa voie, et qu’il s’agit là sa plus grande joie. Vous qui le connaissez, vous savez comme moi que cette voie qui l’a tant comblé, c’est ce rôle de passeur et de la culture et de la littérature japonaises.
Avant de lire « Mode de vie, évasion », je croyais que Keene s’était pris de passion pour le Japon et la littérature japonaise à l’université en découvrant « Le Dit du Genji », roman médiéval sur lequel il a écrit tant de textes en anglais. Je n’avais jamais pensé à faire le lien entre sa solitude d’enfance et ses envies d’ailleurs, c’était là pourtant que se nichait cette sensibilité qui le rendait si réceptif à la culture japonaise.
Post-mortem
« Réflexions sur la mort » est un extraordinaire éventail de vignettes, un chemin de méditation presque, portant sur les différentes morts rencontrées au fil de sa vie. Pourtant au détour d’une phrase, Keene s’arrête et se retourne brusquement la question :
« Que veux-je devenir après ma mort ? Je dois avouer, aussi étrange que cela puisse paraître, que je n’avais jamais pensé à ma propre mort. Rien d’exceptionnel à cela quand on est encore jeune, mais à mon âge, à 67 ans, ne serait-ce pas naturel que l’idée me traverse? Je ne ressentais pas cependant l’imminence de ma mort. »
À peine a-t-il expliqué n’avoir jamais pensé à sa propre mort, que Keene se livre à l’exercice, comme poussé par un esprit de contradiction. Cet essai lui permet alors de se lancer dans une introspection inattendue. Dans les dernières lignes, il se plaît à imaginer l’endroit où il pourrait être enterré et réfléchit aux objets qu’il souhaiterait emporter dans la tombe. Alors qu’il se demande quels livres ou céramiques (il avait l’âme d’un collectionneur) pourraient l’accompagner, après avoir passé en revue différents scénarios, il se reprend pourtant :
« Je n’ai pas vraiment besoin d’une tombe. Si quelqu’un a la gentillesse de se souvenir de moi, peu importe le reste. Comme l’écrivait Shunzei dans son poème :
Qui se remémorera, là
au milieu des orangers sauvages en fleur
qui se souviendra
et pleurera ma mémoire ?
Quand moi aussi, je serai du passé... »
On devine Donald Keene se laisser doucement guider par ce poème qui le prend par la main et le fait réfléchir à ce qui l’attend après la mort. Ces magnifiques stances de Fujiwara Shunzei (1114-1204), tirées de l’anthologie du Shin kokin-wakashû (1205), lui ont-elles donné de la force ?
« Les Beautés du japonais » abonde d’essais fascinants, mais pour moi qui m’intéresse à l’univers intérieur de Keene, « Mode de vie, évasion » et « Réflexions sur la mort » sont à part car dans l’écho de ces deux textes on comprend comment le garçon de Brooklyn qui aimait tant le cinéma est devenu l’érudit et le traducteur que l’on connaît. Un Homme qui se sentait chez lui dans ces deux langues, ces deux cultures et ces deux pays que sont le Japon et les États-Unis.
(Photo de titre : Donald Keene tient un livre dont la couverture représente le poète Ishikawa Takuboku. Photo prise dans son bureau à Tokyo le 29 mars 2016. © Miyazawa Masaaki)
(Voir également notre article du même auteure : Donald Keene et « Le Dit du Genji » : l’apport de la lecture des classiques en traductions modernes)