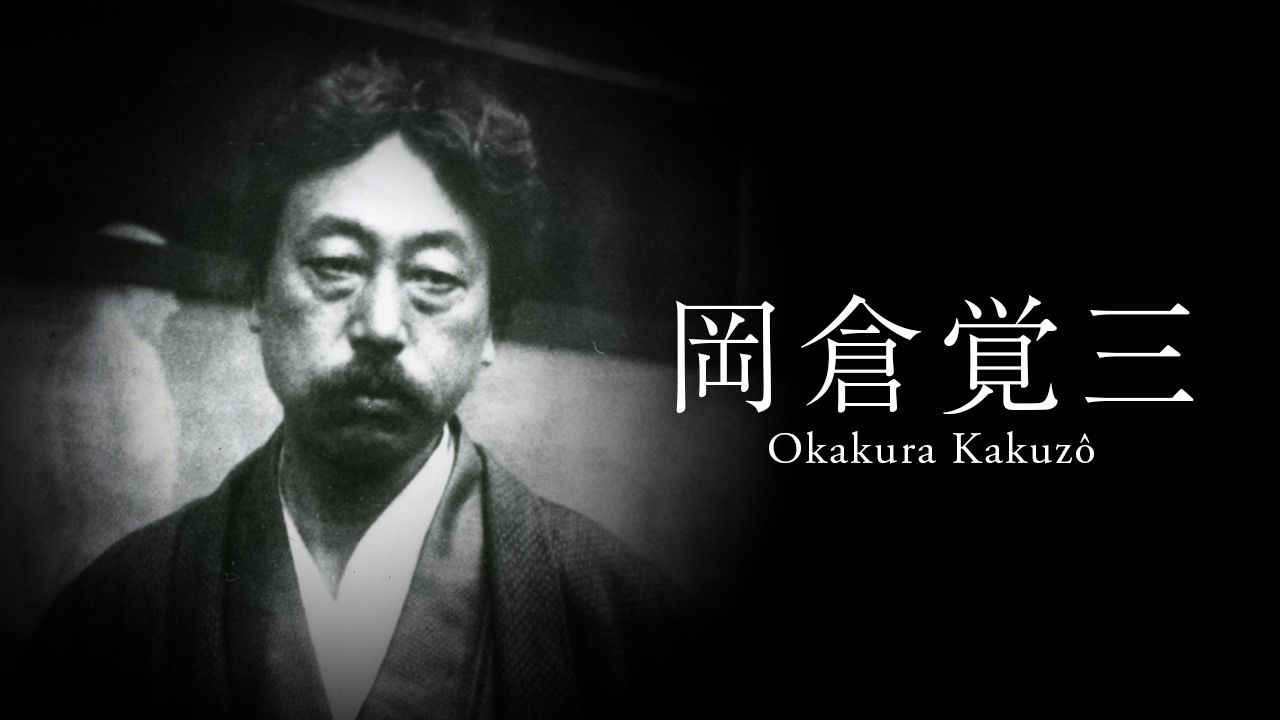Le Livre du thé : un titre simple pour une œuvre profonde
L’urgence des problèmes que le multiculturalisme et la coexistence posent aux sociétés contemporaines s’accroît à mesure que les différentes parties du monde deviennent plus interdépendantes que jamais. Mais jusqu’ici, ce resserrement des liens n’a pas réussi à déboucher sur une compréhension mutuelle, si bien que les tensions entre États et les anxiétés continuent de sévir. Il y a plus d’un siècle, l’écrivain et penseur japonais Okakura Kakuzô (1863-1913) a comparé les nations en lutte pour la suprématie et le pouvoir à des dragons « plongés dans une mer en fermentation » qui « s’efforcent en vain de reconquérir le joyau de la vie ».

Première édition de l’ouvrage Le Livre du thé publiée par Fox Duffield en 1906. (Photo avec l’aimable autorisation de l’Université d’Ibaraki.)
En 1904, année du début de la guerre entre le Japon et la Russie, il est parti aux États-Unis, où il a été le premier Japonais à accéder au poste de conservateur du département d’art chinois et japonais du musée des Beaux-Arts de Boston. Il a écrit trois livres en anglais dans lesquels il partage avec ses lecteurs occidentaux ses idées sur l’art, l’histoire et la philosophie esthétique du Japon et du reste de l’Asie : The Ideals of the East with Special Reference to the Art of Japan, The Awakening of Japan (paru en français en un seul ouvrage : Les idéaux de l’Orient. Le Réveil du Japon) et The Book of Tea (paru en français : Le Livre du thé).
Dans Le Livre du thé, publié aux États-Unis en 1906, Okakura suggérait que, dans un monde mis en pièces par des dragons en guerre, notre espoir le plus sûr consistait à attendre des jours meilleurs. En référence à une déesse de la mythologie chinoise, il écrivait : « Nous avons besoin d’une nouvelle Niuka pour remédier à la grande dévastation ; nous attendons le grand Avatar. » Et entre-temps ? « Entre-temps », écrivait-il, « buvons une gorgée de thé. La lumière de l’après-midi éclaire les bambous, les fontaines babillent délicieusement, le soupir des pins murmure dans notre bouilloire. Rêvons de l’éphémère et laissons-nous errer dans la belle folie des choses. »

Yokoyama Taikan, « Deux dragons se battant pour un joyau précieux », encre monochrome sur soie, 1905. Dans cette peinture, les pins prennent la forme de deux dragons et la Lune celle d’un joyau. (Photo avec l’aimable autorisation du Mémorial de Yokoyama Taikan)
Les mots d’Okakura nous invitent à laisser derrière nous les mers agitées pour entrer dans la lumière et partager une tasse de thé. Cette boisson, désormais très répandue en Occident, se prépare avec des feuilles originaires de l’Orient. Le thé occupe maintenant une place essentielle dans la vie des Occidentaux, et l’habitude de s’accorder un moment de réflexion et de détente en buvant une tasse de thé est quelque chose d’universel, qui constitue un lien entre les peuples du monde. L’interaction entre une hôtesse et ses invités lors d’un thé de l’après-midi met en jeu des formes de courtoisie, d’hospitalité et de conversation très similaires à celles qu’on observe dans le protocole de la cérémonie du thé japonaise. Peut-être est-ce cette révérence dont le thé fait l’objet en Orient comme en Occident qui a inspiré à Okakura cette pensée : « Jusqu’ici, l’humanité s’est rencontrée dans la tasse de thé.
Le Livre du thé passe souvent pour un livre qui vise à introduire la culture japonaise en Occident à travers le prisme de la cérémonie du thé. Mais l’ouvrage véhicule un plus ample message. Sans nier le moindrement les différences culturelles entre l’Orient et l’Occident, il affirme que les deux côtés sont égaux et que l’harmonie est possible entre eux, pour peu que chacun, conscient de la diversité des valeurs et de la validité des différences culturelles, apprenne à manifester de l’intérêt et du respect pour l’autre. Okakura s’est servi avec habileté de la cérémonie du thé pour soutenir qu’une forme d’échange culturel qui rassemble des gens sur une base quotidienne à travers l’humble geste consistant à boire une tasse de thé peut être mise plus largement à contribution à l’échelle planétaire. C’est pour cette raison, me semble-t-il, que les lecteurs du monde entier continuent jusqu’aujourd’hui de l’apprécier.
Un homme sans cesse entre deux mondes
Quel genre d’homme était l’auteur de ces livres ? Dans les passages qu’ils consacrent à Okakura, les manuels d’histoire du Japon mentionnent en général le rôle qu’il a joué dans la fondation de l’École des beaux arts de Tokyo (aujourd’hui Université des arts de Tokyo), d’où sont sortis Yokoyama Taikan (1868-1958) et d’autres peintres du nihonga (peinture japonaise), et dans celle du Nihon Bijutsuin (Institut d’art du Japon), dédié à la peinture de style japonais.
À travers les efforts qu’il a consacrés à la promotion et au soutien d’un modèle artistique inédit qui soit conforme aux sensibilités de l’ère nouvelle tout en restant fermement enraciné dans les traditions nippones, il a apporté une contribution essentielle à l’essor de l’art moderne japonais. Il a en outre joué un rôle important en termes de préservation et de restauration des œuvres d’art traditionnel endommagées lors de la vague d’iconoclasme et de violences antibouddistes concomitante à la Restauration de Meiji (1868). Ses activités l’ont par la suite emmené outre-mer, et il a passé la dernière décennie de sa vie aux États-Unis, où son poste de conservateur du département d’art chinois et japonais du musée des Beaux-Arts de Boston lui a permis de contribuer à faire de ce musée l’un des grands centres d’art extrême-oriental des États-Unis et de former une nouvelle génération de spécialistes américains de l’art asiatique.
La vie et l'œuvre d’Okakura font que son envergure internationale est en général reconnue en Orient comme en Occident. Son tempérament cosmopolite s’est épanoui dans l’environnement culturel hybride de l’ère Meiji (1868-1912), alors qu’il avait un pied dans plusieurs mondes à la fois : Yokohama, Fukui et Nihonbashi ; négociant et samurai ; civilisation occidentale et monde des arts traditionnels japonais. En effet, le père d’Okakura était un samurai de rang inférieur originaire de Fukui, qui avait été envoyé par son domaine à Yokohama dès l’ouverture de ce port au commerce international, pour y faire du négoce, et s’était acquitté de sa tâche avec talent. Après la Restauration de Meiji, sa famille est partie s’installer à Tokyo, dans le quartier de Nihonbashi, où elle a ouvert une auberge et un négoce de soies et autres articles de la province d’Echizen (aujourd’hui préfecture de Fukui). Le jeune Kakuzô a a appris l’anglais à Yokohama et s’est imprégné de la culture occidentale auprès de professeurs étrangers de l’Université de Tokyo, tout en pratiquant les arts traditionnels japonais à Nihonbashi : poésie chinoise, peinture nanga, koto et cérémonie du thé. Il a absorbé simultanément la modernité occidentale et la culture traditionnelle extrême-orientale, qui ont fusionné chez lui en un tout cohérent.
Son diplôme de l’Université de Tokyo en poche, Okakura est entré au ministère de l’Éducation, des Sciences et de la Culture, où il a joué un rôle clef dans l’adoption de politiques adaptées à l’ère nouvelle dans le domaine de l’art, avant de devenir le second doyen de l’École des beaux arts de Tokyo. Pendant un temps, tout semblait aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu’à ce qu’une histoire d’amour avec Hatsuko, l’épouse de Kuki Ryûichi, son supérieur hiérarchique au ministère, vienne jeter une ombre sur sa vie personnelle. À peu près à la même époque, des tensions sont apparues au sein du mouvement en faveur de l’adoption du modèle occidental d’éducation. Il a perdu son poste de doyen de l’École des beaux-arts de Tokyo, avec le chaos qui en a résulté à mesure que les artistes et les enseignants démissionnaient en chaîne pour protester contre cette éviction.
Okakura a fondé alors le Nihon Bijutsuin avec des peintres, des sculpteurs et des artisans qui avaient démissionné pour le soutenir. Bien que basée sur des idéaux forts, la nouvelle institution n’a pas rencontré immédiatement la popularité. Sous la houlette de Yokohama Taikan et de Hishida Shunsô, le nouveau style a tourné le dos aux lignes fortes de la peinture traditionnelle pour adopter une approche plus douce. Il a été assez mal reçu et s’est vu reprocher son caractère « vague » et « flou » (môrôtai). L’institution ayant rencontré des difficultés financières, Okakura a dû se battre pour maintenir en vie son nouveau projet.

Le Rokkaku-dô, construit en 1905 par Okakura sur le littoral d’Izura, dans le nord de la préfecture d’Ibaraki, était un lieu dédié aux retraites et à la méditation. Le bâtiment, détruit par le tsunami qui a balayé le nord-est du Japon le 11 mars 2011, a été reconstruit en 2012. (Photo avec l’aimable autorisation de l’Université d’Ibaraki)
Un penseur internationaliste
Alors qu’il se posait des questions sur son avenir après ces revers personnels et professionnels, Okakura s’est rendu en Inde. Parmi les raisons qui l’ont poussé à faire ce voyage figurait le désir de rencontrer Swami Vivekananda (1863-1902), le moine indien auprès duquel avaient afflué les disciples après le plaidoyer passionné en faveur de l’harmonie religieuse qu’il avait prononcé devant le Parlement mondial des religions réuni à Chicago en 1893. Vivekananda a révélé aux Occidentaux les enseignements des anciennes religions de l’Inde, en prenant acte des éléments universels présents aussi bien dans la philosophie de l’Occident que dans celle de l’Orient et en appelant à un renforcement des échanges entre elles. Cet appel à l’harmonie entre les cultures a dû trouver un écho chez Okakura, engagé comme il l’était dans son propre effort créatif en vue de marier les traditions artistiques du Japon et de l’Europe. Dans Le Livre du thé, Okakura a écrit : « Dans le liquide ambré qui emplit la porcelaine ivoirine, l’initié peut goûter l’exquise réserve de Confucius, le piquant de Lao Tseu et l’arôme éthéré de Çakyamouni lui-même. » L’essence de la liturgie du thé consistait pour lui en une harmonieuse alliance de confucianisme, de taoïsme et de bouddhisme : une diversité qui incluait les meilleurs éléments d’un grand nombre de philosophies, sans se laisser ligoter par aucune religion ou tradition particulière.
Au cours de son séjour en Inde, Okakura a noué une solide amitié avec Rabindranath Tagore (1861-1941). Ce dernier, qui est né à Calcutta, a reçu le prix Nobel de littérature en 1913 pour la richesse de son œuvre poétique, théâtrale et romanesque en bengali. À l’époque de la visite d’Okakura, il était l’une des personnalités les plus en vue de la culture indienne contemporaine. Tagore a sillonné la planète pour présenter la culture et la pensée indiennes au public du monde entier et plaider pour la paix et la coopération entre les nations. Okakura a passé un certain temps avec les artistes rassemblés autour de Tagore, et sympathisé avec les nationalistes indiens qui voulaient libérer leur pays de la tutelle coloniale britannique.

Rabindranath Tagore (Photo avec l’aimable autorisation de l’Université d’Ibaraki)
Des hommes comme Okakura, Vivekananda et Tagore, qui étaient des personnages représentatifs de l’Asie à une époque où la civilisation occidentale semblait occuper une position de supériorité incontestable, se sont efforcés de faire progresser la compréhension des cultures traditionnelles de leurs propres pays — art, religion, histoire et culture de la vie quotidienne — parmi les Occidentaux. Tous trois partageaient le même empressement à faire appel aux éléments universels des cultures « occidentale » et « orientale », et la même détermination à aller de l’avant sur la voie de l’échange et de l’harmonie entre elles.
En Inde, Okakura a pris conscience de la nature et des origines asiatiques de l’art japonais. Cette compréhension est devenue la base de sa vie à Boston, où il s’est efforcé de partager la culture et la pensée japonaises avec le monde entier. Au début de son séjour à Boston, il comparait les États-Unis à une « maison à mi-chemin » entre l’Occident et l’Orient, et disait qu’en collectionnant les œuvres d’art et en apprenant à les apprécier à partir d’une autre culture, on pouvait apporter une contribution significative à l’amélioration de la compréhension entre l’Orient et l’Occident. Okakura voyait les États-Unis comme un endroit où les deux cultures pouvaient se rejoindre au sein d’une nouvelle compréhension, et l’idée de faire du musée des Beaux-Arts de Boston un nouveau modèle de point de rencontre international est au cœur de sa conception de son métier de conservateur. Avec une équipe d’aides japonais et américains, il a jeté les fondations d’une des plus remarquables collections d’art extrême-oriental qu’on puisse trouver aux États-Unis. Les conservateurs qu’il a formés par la suite ont été employés par des musées disséminés sur tout le territoire national, et ils se sont consacrés aux échanges culturels entre les deux pays jusqu’à ce que la guerre du Pacifique éclate en 1941.

Le libretto de l’opéra The White Fox (Photo avec l’aimable autorisation de l’Université d’Ibaraki)
La dernière œuvre d’Okakura a été The White Fox, un libretto d’opéra basé sur la légende de Shinodazuma (l’histoire d’un renard blanc de la forêt de Shinoda qui prend la forme d’une belle femme et épouse un homme avec lequel elle conçoit un enfant avant que sa véritable identité soit démasquée et qu’elle retourne dans la forêt). Okakura utilise le genre occidental de l’opéra pour créer une œuvre traitant de thèmes universels : l’amour d’une mère pour son enfant et la douleur de la séparation. L’enfant né de l’union entre renard et être humain est une créature miraculeuse qui réunit deux mondes irréconciliables. Quand la mère doit retourner dans la forêt, elle confie à son fils une balle magique qui prédit un avenir porteur d’harmonie entre les deux mondes. On peut sans aucun doute discerner des assonances avec le « joyau de la vie » pour lequel se battaient les dragons dans les premiers passages du Livre du thé.
Plus d’un siècle après la disparition d’Okakura, d’innombrables dragons continuent de se battre pour la suprématie et le pouvoir dans une « mer en fermentation ». Alors que le monde s’enfonce de plus en plus profondément dans le chaos et la confusion, l’humanité n’a toujours pas trouvé de solution pour rétablir l’ordre et réparer les ruines et les ravages engendrés par des siècles de conflit. Aujourd’hui plus que jamais, le besoin se fait sentir d’un retour aux idées d’Okakura. Sa philosophie de sagesse et de tolérance prend une importance inégalée dans un âge où les tensions entre les États et les peuples semblent plus intenses et menaçantes qu’elles ne l’ont été depuis un certain temps.
(Photo de titre : Okakura Kakuzô, également connu sous le nom d’Okakura Tenshin. Photo prise au musée des Beaux-Arts de Boston aux environs de 1904. Avec l’aimable autorisation de l’Université d’Ibaraki)